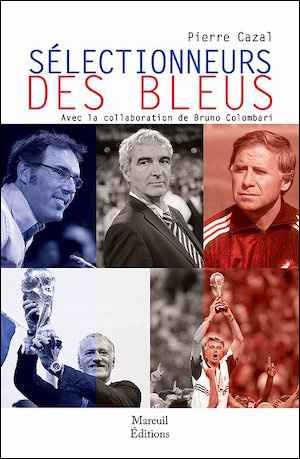Trois lignes, page 471, alors que l’histoire touche à sa fin. Trois lignes qui en disent beaucoup sur la démarche de David Lagercrantz, biographe de Zlatan Ibrahimovic et choisi par l’éditeur Norstedts pour reprendre la série Millénium :
Au fil de sa lecture — et c’était là tout le talent de Mikael Blomkvist — Gabriella fut autant scandalisée par la description des affaires politiques que touchée par le drame humain.
Remplacez Mikael Blomqvist par Stieg Larsson, et vous avez là un hommage que l’on suppose sincère de Lagerkrantz à son prédécesseur. Certes, Larsson n’était pas un grand styliste du langage noir comme peuvent l’être Roger Jon Ellory, James Lee Burke ou Dennis Lehane. Mais il savait doser à la perfection la politique et l’intime, les tragédies personnelles et la raison d’Etat. Son talent était là, et bien sûr dans les personnages qu’il avait inventés. Lisbeth Salander, version punkette et hackeuse de Fifi Brindacier, avait pris toute la place dans la trilogie initiale, reléguant Mikael Blomkvist au rang de faire-valoir.
Millénium a été un succès planétaire aussi inattendu que juteux (75 millions d’exemplaires vendus), d’autant plus que son auteur, on le sait, n’en a jamais vu la couleur : Stieg Larsson est mort avant la publication de la trilogie, en novembre 2004. Mais il était terriblement tentant de ressusciter ses personnages en demandant à un autre d’imaginer la suite. Pas celle contenu dans ce désormais légendaire quatrième manuscrit détenu par la compagne de Larsson. Une suite située dix ans plus tard, et impliquant cette fois la NSA et ses grandes oreilles.
Au-delà du procès en illégitimité intenté en Suède contre Lagercrantz, que vaut vraiment Ce qui ne me tue pas ? Le résultat n’est pas honteux, loin de là. Comme on pouvait s’y attendre, la dimension politique est bien plus faible (il s’agit plutôt ici d’espionnage industriel à grande échelle qui n’a rien de spécifique à la Suède) et le parti pris féministe de Larsson est repris mollement par Lagerkrantz. Le scénario tient plutôt bien la route, sans grande originalité mais soigneusement documenté (intelligence artificielle, autisme, mathématiques) et une fois de plus, c’est Lisbeth qui sauve la mise à tous les sens du terme.
Comme dans la trilogie initiale, elle apporte une touche de folie dans un ensemble plutôt lisse, un élément incontrôlable dans une machinerie bien huilée. On est ravi de la retrouver telle qu’on l’avait laissée dix ans plus tôt, même si parfois [1] Lagercranz en fait une sorte de super-héroïne invincible et omnisciente.
Le plus gros défaut de ce tome 4, ce sont les cinquante premières pages qui font tomber le livre des mains tant le style y est lourd, sans élan, sans aucune dynamique. Ça va mieux par la suite — et notamment quand entre en scène le responsable de la sécurité réseau à la NSA, Edwin Needham, dit Ed The Ned. C’est lui le pendant américain de Lisbeth, et dans sa démesure et son originalité (il insulte copieusement ses subalternes comme ses supérieurs, y compris le secrétaire d’Etat à la Justice) il aurait mérité une place plus grande. Quand il découvre une intrusion informatique dans le saint des saints, il jure qu’il n’aura pas de repos tant qu’il n’aura pas coupé les couilles au hacker capable d’une audace pareille. Il ne connaît pas encore Lisbeth.
Pour finir, les remerciements de l’auteur à Erland et Joakim Larsson, le père et le frère de Stieg, sont pour le moins déplacés. Ce sont plutôt eux qui devraient remercier Lagercrantz et Norstedts d’avoir relancé la machine à cash (le tome 4 est sorti dans 25 pays à la fin du mois d’août). Seuls ayants-droits de l’immense fortune générée par la trilogie, ils peuvent s’offrir le luxe de reverser une partie des bénéfices à la revue Expo créée par Stieg Larsson. Ce que l’on peut appeler s’acheter une bonne conscience.